Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville
Baptisé à Narbonne le 25 décembre 1711 et mort à Belleville (Paris) le 8 octobre 1772, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville est un compositeur, violoniste et chef d'orchestre français.
Bien qu'appartenant à une génération ultérieure, Mondonville est contemporain de Jean-Philippe Rameau. Il naît dans une famille aristocratique occitane qui a connu des revers de fortune. Entre 1735 et 1737, on le trouve comme maître des violonistes aux « concerts de Lille ». Il s'installe à Paris en 1738 et est engagé, grâce à la protection de Madame de Pompadour, comme violoniste au Concert Spirituel. Pendant les années 1740, il poursuit sa carrière de violoniste, même si le motet “Venite, exultemus Domino”, publié en 1740, lui vaut le poste de sous-maître de musique de la Chapelle, précisément du quartier du mois de juillet. En 1747, il épouse Anne-Jeanne Boucon, claveciniste célèbre à qui Rameau avait dédié en 1741 une de ses pièces de clavecin en concert, œuvre qui reprenait une formule mise au point par Mondonville lui-même dès son opus III en 1734.
Dans la querelle des Bouffons (1752 à 1754), il prend le parti de la musique française. Sa pastorale héroïque Titon et l'Aurore, dont la première a lieu le 9 janvier 1753 à l'Académie royale de musique, est un événement important destiné à imposer la supériorité de la tragédie lyrique française. Pourtant, l'année suivante, Mondonville compose le livret et la musique de son opéra en occitan, Daphnis et Alcimadure, où, par des emprunts à différents intermèdes italiens représentés en France à la même époque, se perçoit nettement l'influence du style italien.
Entre 1734 et 1755, il compose 17 grands motets, dont seules neuf partitions nous sont parvenues. La musique de Mondonville se caractérise par son inventivité et son expressivité. On peut citer la lenteur hiératique du Dominus regnavit, l'impétuosité du Elevaverunt flumina et le lyrisme du Gloria patri dans le même motet (Dominus regnavit), ou bien le modernisme fougueux du verset Jordanis conversus est retrorsum dans le motet In exitu Israel. Grâce à une grande maîtrise orchestrale et vocale, Mondonville apporte au genre du grand motet — genre dominant du répertoire de la Chapelle royale jusqu'à la Révolution — une couleur, un dramatisme inhabituel, qui font de ses œuvres des créations remarquables de la musique baroque.
En 1755, après la mort de Pancrace Royer, Mondonville le remplace au titre de directeur du Concert Spirituel jusqu'en 1762.
Pierre-Louis D’Aquin de Château Lyon, dans son Siècle littéraire de Louis XV ou Lettres sur les hommes célèbres, se montre particulièrement prodigue d’éloges sur ce Narbonnais : « Mais si je n’étais pas Rameau, qu’aurais-je de mieux à désirer que d’être Mondonville ? ». Voilà qui nous fait infiniment regretter les pertes d’autres grands motets et en particulier de ceux en français (Les Israélites à la montagne d’Horeb, 1758, Les fureurs de Saül, 1759) ou encore cet intriguant Concert à trois chœurs (1738) dont on peine à imaginer les contours.
Cette originalité ne réside pas seulement dans le caractère novateur de ses compositions mais aussi dans des spécificités d’écriture qui font sa marque de fabrique : il possède ainsi une prédilection pour les francs unissons massifs aussi bien au chœur qu’à l’orchestre, connaissant parfaitement l’énergie qui s’en dégage. Pour autant, il sait recourir également à un contrepoint d’une rare élégance et manie les dialogues entre textures avec une aisance étourdissante. De surcroît, ses récits et ensembles sont marqués par un charme mélodique évident qui séduisent immédiatement l’auditeur. Son inventivité s’exprime enfin dans les contrastes qu’il sait insuffler aux différentes sections d’un motet, parfois même au sein d’une même page, illustrant les textes sacrés avec une rare intelligence, sachant dépasser un trait décoratif qu’on a pu parfois lui reprocher : bien des épisodes sont empreints de profondeur et c’est souvent un souffle réellement épique qui éclate avec une puissance très impressionnante en de nombreux endroits.
Datant de la période lilloise (1734), le “Dominus regnavit” possède encore quelques traits de l’écriture de Lalande. La fugue toute française s’établit sur le matériau présenté dans la ritournelle introductive, et fait montre d’une fière allure par son rythme pointé. L’homophonie règne à partir de la modulation en si bémol majeur avec une mise en valeur de “Decorem indutus est” avant de réaffirmer le sujet initial à l’unisson et de conclure magistralement cette page qui ne pouvait que saisir les contemporains.
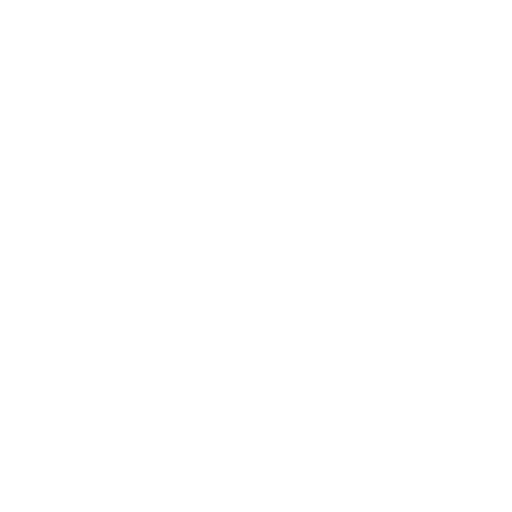
Aucun commentaire